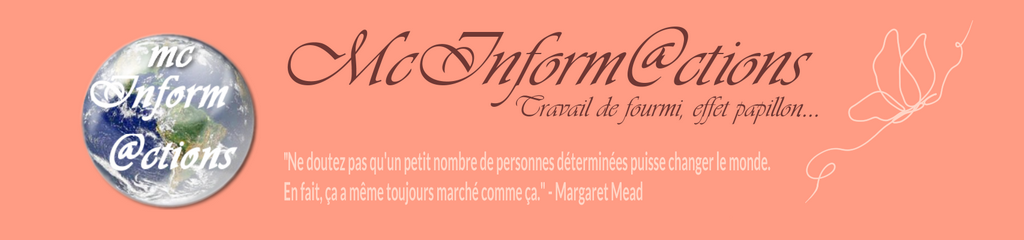À la veille des très prochaine élections législatives, la Vigie de la Laïcité publie une version mise à jour de l’analyse très précise effectuée par Philippe Portier, politiste et membre du CA de la Vigie de la Laïcité, sur les conceptions de la laïcité portées par les différents candidats à l’élection présidentielle de 2022. Cette nouvelle version de l’analyse originellement publiée sur Le Grand Continent reste a priori d’actualité et vous permettra de juger en toute conscience lorsque vous irez voter pour élire vos député.e.s.
(...) les douze candidats retenus par le Conseil constitutionnel présentent des programmes à large spectre abordant la plupart des problèmes auxquels se sent confrontée la société actuelle : parmi d’autres, la question écologique, le problème du pouvoir d’achat, le défi de la sécurité, la politique internationale, les droits des familles, la place de la ruralité. Bien entendu, les prétendants n’articulent pas toutes ces thématiques de la même manière (...) (...) (...) (...) (...)
Consolider le pacte social
La question laïque avait affleuré, en 1974 et 1981, sous le prisme particulier du devenir de l’école privée4, dans le cadre d’une société politique qui, depuis les années vingt, avait globalement, y compris du côté des catholiques, accepté la loi de séparation du 9 décembre 1905. Les élections de 1988, 1995, et 2002 ne lui laissent aucune place, en dépit de la controverse autour des « foulards islamiques » à partir de l’automne 1988. Il faut attendre 2007 pour que les principaux candidats – Jean-Marie Le Pen, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy – la réintègrent dans leurs programmes respectifs. Le tournant s’accentue en 2012 : tandis que Nicolas Sarkozy persévère dans sa vision culturaliste de la laïcité5, François Hollande approfondit, quant à lui, la tradition séparatiste, en promettant dans son discours du Bourget une constitutionnalisation de la loi de 1905. Le thème est demeuré depuis lors. Les programmes de 2022 en traitent abondamment, en le rapportant le plus souvent à la nécessité de renforcer les fondations – interprétées différemment par les candidats – de la convivialité politique.
Ce retour s’inscrit dans un contexte nouveau. Trois transformations, qui se cristallisent à partir des années 1980, méritent d’être signalées.
La première concerne la scène religieuse6. Le processus de sécularisation qui la marque la France depuis la Révolution française s’est certes amplifié : il est aujourd’hui bien moins de pratiquants et même de croyants qu’hier. Simultanément cependant, des effervescences inédites se sont affirmées : dans toutes les familles confessionnelles, les fidèles, au risque de troubler les compromis sociaux construits au cours des décennies antérieures, ont exprimé des demandes de droits particuliers, et parfois même des revendications plus globales visant, comme ce fut le cas avec les mobilisations contre le mariage entre personnes du même sexe ou contre les publications « blasphématoires », à recomposer le rapport de la norme positive et de la norme religieuse. Il en est résulté une inquiétude collective qui, pour diverses raisons au centre desquelles figure la question des attentats, s’est noué autour de l’islam.
La deuxième mutation concerne la scène idéologique. La controverse intellectuelle s’est longtemps organisée en son sein autour de ce qu’Alain Badiou appelait « l’hypothèse communiste » : il s’agissait de savoir comment, et dans quel régime politique, devaient être distribuées les richesses de l’effort collectif. Depuis les années 1990, avec le tournant libéral de la gauche et la chute du mur de Berlin, le registre n’est plus le même : l’esprit public s’interroge désormais sur les modes d’articulation possibles de la relation entre appartenance civique et adhérence religieuse : la question de la gestion de la diversité culturelle tend à se substituer, ou à se superposer du moins, à celle de la production de l’égalité sociale.
Le troisième changement touche à la scène politique. Son point d’équilibre s’est déplacé vers la droite. Un populisme conservateur s’est constitué, d’abord autour du Front national, puis du Rassemblement national et de Reconquête, au point d’apparaître comme une alternative gouvernementale, capable de se substituer, comme l’ont montré les résultats électoraux de ses représentants aux élections présidentielles depuis 2002, aux forces (classiques) de droite et de gauche qui se sont succédé au pouvoir depuis la Seconde Guerre mondiale. Or, cette mouvance, qui place au premier rang de ses préoccupations la « protection » de la France éternelle contre les éléments immigrés, « musulmans » le plus souvent, qui en menacent la culture, a redéfini l’agenda de ses concurrents : sans leur dire « comment penser », elle leur a du moins indiqué « à quoi penser »7.
On ne s’étonne donc pas que, comme l’ont bien montré les études lexicométriques, le syntagme « laïcité » soit aujourd’hui, souvent en co-occurrence d’ailleurs avec les mots « islam » ou « musulmans », dix fois plus employé dans les textes publics (livres, presse, discours) que dans les années 1900, après avoir connu une montée en puissance depuis les attentats du milieu des années 1990 (...)