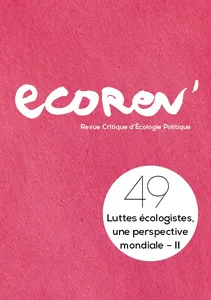
Face à une société capitaliste qui court à sa perte en sapant le monde du vivant, l’éclosion d’une pensée économique et politique autre s’avère plus que jamais nécessaire. À travers le communalisme, l’écologiste et anarchiste Murray Bookchin augure d’une société organisée en démocratie directe par des assemblées populaires communales. Mais derrière le localisme affiché, c’est bien une réactualisation du modèle politique confédéral à grande échelle dont il est question.
Inspirée de l’écologiste américain Murray Bookchin (1921-2006), l’écologie sociale dessine un horizon : l’image d’un monde qui pourrait se réaliser, très concrètement, afin que les sociétés humaines s’émancipent et réintègrent dans leur diversité les écosystèmes en une relation symbiotique et en constante évolution. Pour cela, l’écologie sociale propose des moyens politiques destinés à nous sortir de l’impasse actuelle par le développement d’une démocratie directe municipale et confédérale. Un projet politique qui se veut une alternative au couple dominant État-nation /démocratie représentative qui trouve ses limites face au nouvel état mondial globalisé. (...)
L’institution centrale de cette politique serait l’assemblée populaire fonctionnant en démocratie directe. C’est-à-dire qu’à la place de partis et d’élections de politicien·ne·s, se verrait instituée une assemblée ouverte à tous les habitant·e·s désirant prendre part à la gestion de leur lieu de vie. Dans ces assemblées, on se rencontre, on débat, on prend des décisions sur des points annoncés à l’ordre du jour, chacun peut proposer des lois, etc. Les assemblées communales au sein du communalisme se veulent autonomes politiquement. Elles rédigent leur constitution municipale sur les droits et libertés des citoyens et sur ses modes de fonctionnement. C’est le lieu d’exercice du pouvoir en commun qui élit pour faire appliquer ses décisions des délégués strictement mandatés et révocables à tout moment. Le pouvoir se veut ainsi rotatif pour éviter la spécialisation et en faciliter l’accès à tout le monde. (...)
Dès le départ, le projet de l’écologie sociale s’est inscrit dans le courant de pensée des tenants d’une décentralisation de la société. Face à l’État-nation et son administration centralisée et homogène, il est question d’un retour à une gestion à partir du bas, avec une production non plus considérée en termes de rentabilité, mais au plus proche de son espace d’utilisation.
Bookchin s’inscrit très tôt dans les pas d’urbanistes critiques de l’étalement urbain, comme Lewis Mumford, qui fut un de ses mentors, mais aussi Erwin Anton Gutkind 6. Une tradition qui a toujours été forte auprès des écologistes autant que des anarchistes et qu’on retrouve poursuivie par des ouvrages comme Small is beautiful de Schumacher ou Bolo’bolo, du Suisse P.M.
Le principe, posé dès ses premiers essais, notamment Crisis in our Cities en 1965, présente le besoin d’un retour à des communautés à échelle humaine et adaptées à leur environnement proche. Un principe qui part d’un constat : les villes, à force de s’étendre, ont perdu leur logique, leur relation directe avec celles et ceux qui l’habitent. Elles se sont distanciées de leur caractère communautaire pour voir déteindre sur elles le monde de l’économie : gérées comme des entreprises, les cités se retrouvent en concurrence les unes avec les autres, doivent dégager du profit et deviennent même de plus en plus spécialisées – « simplifiées » dira Bookchin : « Les écosystèmes complexes qui constituent les diverses régions des continents disparaissent sous une organisation qui fait de nations entières des entités économiques rationalisées, simples étapes de la chaîne de production planétaire » 7.
Avec la perte de repères et d’identité des villes, leur « sens » humain a également disparu. (...)
L’écologie sociale va dès lors plaider pour renouer avec un espace de vie porteur de sens. Il s’agit de mettre fin à l’opposition entre le centre (lieu d’activités) et la périphérie (lieu dortoir) et revenir à une forme mixte entre la ville et la campagne. Il s’agit de faire rentrer cette dernière au cœur des cités et montrer clairement les interactions et l’interdépendance entre notre environnement direct et nos vies.
Décentraliser la société vise un effet aussi bien écologique que social : moins de déplacements, des circuits courts d’approvisionnement, une production à visée locale et planifiée en fonction des besoins, avec moins de pertes, etc. Il s’agit de créer une économie à petite et moyenne échelle dévolue à la satisfaction des besoins réels des habitant·e·s qu’elle recouvre et auxquels celles et ceux-ci prennent directement part. (...)
Néanmoins, le développement de quartiers et villages autogérés ne représente pas aux yeux de Bookchin une fin en soi. Il se défend même ardemment d’être partisan du localisme, d’un biorégionalisme ou tout autre retour à des communautés indépendantes et coupées les unes des autres. (...)
Le projet politique communaliste cherche à développer un vaste réseau organisé de communes libres – une « Communauté de communes » pour reprendre les termes de Bookchin – se coordonnant entre elles pour les échanges économiques, la production énergétique, le partage d’infra-structures à large rayonnement comme les hôpitaux, les universités, etc. Une coordination politique de fait indispensable pour répondre aux besoins des populations et assurer l’approvisionnement des biens et services indispensables. Le système suit dès lors la forme confédérale d’un réseau d’interrelations, avec des échelons politiques locaux, puis régionaux alliant plusieurs communes, et supra-régionaux, regroupant plusieurs régions. Chaque étage reproduit le modèle local et possède sa propre assemblée où sont prises les décisions demandant une réponse à cette échelle géographique. (...)
le communalisme dans sa stratégie pour la transition pointe sur le besoin fondamental de création non d’un parti mais d’un mouvement politique qui toucherait bien au-delà de la sphère parlementaire. (...)
Le municipalisme libertaire se veut ainsi révolutionnaire sur le fond plus que sur la forme : il ne compte pas sur la réussite d’un soulèvement populaire dont émergeraient ensuite les nouvelles institutions démocratiques. Les exemples passés et récents ont continuellement prouvé la confiscation du pouvoir par les élites et la non-réalisation des idéaux ayant fait naître les révolutions. On peut en revanche dès à présent chercher à créer un nouveau modèle politique confédéral, en marge des anciennes structures.
Au niveau local, l’enjeu n’est pas d’atteindre la mairie par une élection politique, mais de vider les institutions de leur sens, de leur légitimité, par l’autogestion et une réappropriation populaire des pouvoirs publics. (...)
La prise en compte de la diversité demeure le seul garde-fou qui tienne. L’apport du projet localisé confédéral consiste justement dans la marge de manœuvre et d’autogestion offerte à chacune de ses composantes. Les différences culturelles et identitaires doivent pouvoir s’exprimer en son sein pour faire vivre un ensemble hétérogène. (...)
On aime à rappeler le sens profond du mot « radical », qui vient de racine. Des racines qui partent de la terre, faites de multiples ramifications qui, ensemble, viennent alimenter un arbre et ses fruits. Ce sont ces derniers que le mouvement confédéral espère voir mûrir.
