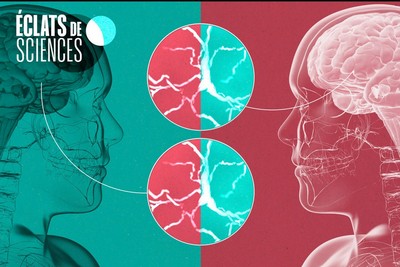
Lorsque nous interagissons, nos cerveaux ont la capacité à entrer en synchronisation avec d’autres cerveaux. Un phénomène qui commence tout juste à être décortiqué par la neuroscience. Et nous oblige à changer de regard sur nos habiletés sociales
Décidément, plus la science s’acharne à comprendre ce qui fait de nous des individus uniques, dotés d’une conscience propre, plus on découvre à quel point nous sommes reliés, interdépendants. Y compris à l’intérieur même de nos boîtes crâniennes. En étudiant non plus un seul cerveau à la fois mais plusieurs, en interaction les uns avec les autres, une surprenante découverte émerge : la synchronisation inter-cérébrale. Ou comment deux cerveaux, voire plus, finissent par se retrouver sur… la même longueur d’onde.
Il y a encore vingt ans, ce champ de recherche était vu comme une science occulte. (...)
De la télépathie à la neuroscience
Au début des années 2000, différentes équipes vont à nouveau se pencher sur l’observation simultanée de plusieurs cerveaux. Et ce, grâce à deux types d’outils : l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) qui mesure indirectement l’activité nerveuse via le taux d’oxygénation des capillaires sanguins ; et l’électroencéphalographie (EEG) qui enregistre directement l’activité électrique de groupes de neurones. Lorsqu’il y a synchronisation, les pics et les creux des signaux électriques finissent par être en phase.
Au début, la plupart des études portaient sur deux individus engagés dans une interaction contrôlée (...)
Première conclusion : certaines populations de neurones voient leurs ondes électriques se synchroniser à l’intérieur des différents cerveaux.
« Cette synchronisation avait été observée entre différentes aires du cerveau, mais pas entre différents cerveaux », retrace Julia Sliwa, chargée de recherche CNRS à l’Institut du cerveau. Toutefois, pour enthousiasmants qu’ils soient, ces résultats ne représentent pas une réelle surprise. Plongés dans un environnement similaire, nos cerveaux réagissent de la même manière. Après tout, nous sommes faits du même moule.
Les cerveaux s’influencent entre eux
Sauf qu’en réalité, ce n’est pas que ça. En observant des paires d’individus dans des interactions spontanées, sans qu’ils fassent ni regardent la même chose, des chercheurs découvrent que ce couplage cérébral se produit également. (...)
D’autant plus que ces interactions entraînent des synchronisations extrêmement précises : les ondulations se superposent à quelques millisecondes près.
Depuis lors, des dizaines d’équipes dans le monde tentent de décortiquer cette synchronie intercérébrale. Chez l’homme, mais aussi chez l’animal (...)
cette synchronisation n’est pas systématique et sa précision varie en fonction de nombreux critères. (...)
Un marqueur de nos relations sociales ?
Plus surprenant : le niveau de synchronisation est également influencé par la nature de la relation entre les personnes impliquées dans l’interaction. Plus ils sont proches, plus les individus se connaissent depuis longtemps, plus la synchronisation est forte. (...)
Enfin, il y a aussi des éléments propres à chaque individu qui peuvent accroître ou au contraire perturber cette synchronie. Le niveau de stress des personnes apparaît par exemple négativement corrélé à la synchronisation (...)
De la même manière, si l’on est motivé et attentif durant l’interaction, le niveau de couplage est meilleur. (...)
À l’origine de la sociabilité ?
Au-delà de l’impact de ce phénomène sur nos performances cognitives, un autre élément émerge de ces nouvelles études. Que ce soit lors des interactions entre couples, entre étrangers, au sein d’une classe, lors d’un concert : plus les individus synchronisent, plus ils rapportent un sentiment de satisfaction, de plaisir. (...)
Ces découvertes pourraient modifier notre façon d’envisager certains troubles neurobiologiques, en particulier l’autisme. Plutôt qu’un dysfonctionnement de certaines régions cérébrales, ces troubles pourraient relever d’une moindre capacité à entrer en synchronisation. (...)
Les oscillations neuronales qui se propagent dans les différentes aires de notre cerveau sont considérées comme la base neuronale de notre conscience, explique-t-il dans un article intitulé « Ce qui nous lie », co-écrit avec Ana Lucía Valencia de l’Université nationale autonome du Mexique.
Le fait que ces oscillations puissent également se propager entre différents cerveaux invite à remettre en question notre « vision standard de la conscience humaine comme étant essentiellement une conscience à la première personne ». Pourrait-on concevoir une sorte de conscience étendue, une conscience collective ?
Une chose est sûre, insistent tous ces spécialistes, les interactions entre nos milliards de neurones ne peuvent suffire à définir notre conscience. Il faut désormais prendre en compte ces phénomènes de synchronisation avec les cerveaux qui nous entourent.
