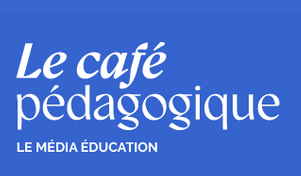
D’un·e ministre à l’autre, les programmes continueront-ils à subir le rouleau compresseur du passéisme ? Une révision des programmes de français et de mathématiques du cycle 3 a été demandée en mars 2024 par Nicole Belloubet, alors ministre de l’Education nationale : le Conseil Supérieur des Programmes a rendu publics ses projets le 7 janvier 2025 et ouvert une consultation jusqu’au 7 février 2025. L’Association Française pour l’Enseignement du Français (AFEF) n’a pas été sollicitée dans la phase de préparation. Viviane Youx, présidente de l’AFEF, livre au Café pédagogique son analyse et son verdict, sévères : « Jusqu’où vont tenir les enseignant·es à force de réduction de leurs ambitions éducatives ? Comment supporter les contradictions incessantes avec leur formation et les travaux de recherche, comment réussir à engager durablement l’intérêt des élèves, et les accompagner dans la diversité de leur rapport à l’école et à la langue française ? »
Une procédure contestable
Que faire face au rouleau compresseur de programmes de français élaborés sans concertation ? Et si l’objectif premier était de balayer définitivement les programmes de 2015, qui rassemblaient toutes les disciplines en les reliant au socle commun ? …
Nous venons d’être informés d’une consultation nationale sur les programmes de français et de mathématiques au cycle 3. Une lettre de saisine du 13 mars 2024 de la ministre de l’Éducation nationale (laquelle ? nous nous y perdons pour 2024…) demandait au Conseil supérieur des programmes (CSP) de réviser ces programmes. Révision ? non, car c’est d’une refonte totale, d’une rédaction nouvelle qu’il s’agit.
Et, pour le français, sans aucune concertation durant leur écriture, puisque le CSP est maitre du choix des personnes et organismes qu’il auditionne : l’AFEF (Association Française pour l’Enseignement du Français) ne faisait visiblement pas partie de ce choix. Un grignotage de plus dans une élaboration démocratique des programmes puisque la règle est devenue précipitation et opacité !
Nous voici donc au point d’orgue de remaniements successifs des programmes qui depuis 7 ans ont instauré un revirement passéiste. Le schéma de sujétion des enseignants et des enseignantes est bouclé : simples exécutant·es d’une multiplicité d’items à appliquer !
Qui a rédigé ces textes ? Qui a été consulté pour que nous nous trouvions face à des changements aussi profonds et des ambitions aussi conservatrices ? Pas des chercheurs et chercheuses en didactique du français, ni des praticiens et praticiennes innovantes. Où sont les années de réflexion collective menée notamment par l’AFEF dans sa revue Le français aujourd’hui ?
Et pourquoi de nouveaux programmes seulement en maths et en français ? (...)
Le français et les maths sont alors posés comme des « fondamentaux », au détriment des autres matières, et on en oublie l’enseignement des langages dans les disciplines, dont la visée première est d’amener les élèves à penser, questionner, s’exprimer, se cultiver, en complémentarité.
Et ces textes s’adressent à un élève virtuel dans des principes centrés sur des tâches et catégories, sans en interroger le sens, ni poser de finalités pour les enfants comme personnes. (...)
chaque cycle nous livre un catalogue de rubriques, de la fluidité à l’œuvre littéraire, avec des items très précis dont le but premier semble être de cadrer le travail des enseignants, qui n’auraient plus qu’à cocher ce qui a été fait. Comme si la lecture, la compréhension, pouvaient être une question de cases à cocher ! Même la fluidité, indispensable, ne présage pas de ce que l’enfant comprend. Quant à l’entrée « Lire et comprendre des textes, des documents et des images pour apprendre dans toutes les disciplines », dont nous ne pouvons que nous féliciter, comment font les enseignant·es pour se concerter avec leurs collègues ? Car si en primaire règne la polyvalence, ce n’est plus le cas en sixième.
Dans la partie Écriture, certains principes pointés sont justes. Mais les « différentes situations d’écriture » et « projets d’écriture, y compris créatifs » sont noyés dans l’entrainement, les « gammes d’écriture », la production, plutôt que l’écriture au long cours, constante, régulière, qui permet de penser, réfléchir, comprendre, travailler. Écriture sous contrainte plutôt que processus, même si le mot apparait une fois. Pas sûr que ces pratiques « scolaires » laissent des traces durables et se transfèrent dans les pratiques « naturelles » d’écriture ! Et plus on avance dans la lecture du projet, plus on comprend que la déclaration liminaire[1] sur les compétences langagières dans les disciplines se dilue dans des injonctions relevant davantage de la maitrise de compétences linguistiques sans lien avec les compétences langagières.
Continuons par la fin : langue ou langages ? (...)
Des malentendus entretenus
Malgré de nombreux travaux d’expertes et experts reconnus dans le monde des professeur·es, le projet charrie de nouveau des idées fausses ou erronées, que l’on ne cesse d’essayer de déjouer en formation. (...)
Nous refusons ces programmes et demandons leur réécriture à partir de concertations avec les associations, syndicats, chercheurs selon la tradition du CSP. Peu à peu, depuis 2018, des révisions ont été imposées dans les programmes du socle commun, mais pour l’élaboration de programmes du lycée général et professionnel, le CSP faisait appel aux associations représentatives.
Là c’est un autre cap qui est franchi : des programmes de français édictés en roue libre, sans concertation ! Quel excellent moyen de revenir à des « traditions » qui ne fonctionnent plus avec les élèves actuels. Un nouveau tri s’opère : l’ennui à l’école pour le plus grand nombre, le plaisir d’écrire-lire-parler pour quelques chanceux, grâce à des conditions familiales ou territoriales favorables, grâce à des enseignant·es qui tenteront de garder leur liberté. Jusqu’à leur mise au pas par des programmes contraignants ?
