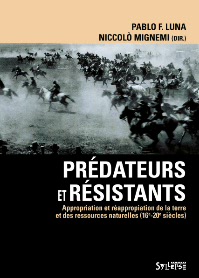
Loin de rester endormie sur ses lauriers, et bien souvent à rebours des discours sur son archaïsme prétendu, dans un monde globalisé et vraisemblablement promis à l’uniformité capitaliste, l’histoire des campagnes et des mondes ruraux a continué de produire, au cours des dernières années, d’importants travaux de recherche et d’apporter des résultats singuliers et utiles. Il faut dire que le retour en force de l’intérêt pour la terre et le territoire, pour l’agriculture et pour la nourriture, sur une planète qui dépassera bientôt les dix milliards d’habitants, a contribué à décloisonner les approches fondamentalement nationales qui avaient jadis prévalu, notamment en Europe, en histoire rurale. Ce retournement a conduit à s’interroger, désormais à l’échelle du monde, sur la diversité des voies empruntées par la croissance et par le progrès agricoles, confrontés dans le passé à des défis et à des enjeux comparables à ceux d’aujourd’hui.
Les travaux réunis dans cet ouvrage s’insèrent volontairement dans cette transition et dans cet état d’esprit novateur, et posent l’une des questions centrales dans l’évolution des campagnes dans le monde, à savoir celle de la possession de la terre et de son environnement humain et naturel. L’approche choisie par les contributions incorporées dans ce livre a été celle de la mise en commun des outils de l’histoire et des sciences sociales et juridiques, afin d’enrichir la connaissance par la confrontation des savoirs et des méthodologies.
En fait, depuis la fin du Moyen Âge, au moins, l’appropriation de la terre et de l’ensemble des ressources naturelles et humaines a connu une grande variété d’expériences, menée tour à tour par plusieurs protagonistes. (...)
La nécessité de légitimer et de légaliser l’appropriation, dans chacune de ses manifestations, que ce soit en Europe ou ailleurs, aux yeux des protagonistes et des concurrents potentiels, a pu consolider la perception de sa « nature inéluctable », de sa « nécessité historique ». Ce sont des prétentions qui continuent, encore de nos jours, à alimenter des diagnostics et des propositions – sinon des postures idéologiques. Du coup, l’appropriation a pu devenir un fait intégral, parfois considéré comme étant inné et essentiel, ou un vecteur irrésistible du progrès et de la civilisation, apportés à ceux qui – prétendument - en étaient dépourvus, et ceci, non pas seulement dans les nouveaux espaces soumis et colonisés.
La conviction de « bien agir » ou de « fonder institution » (là où il n’y aurait eu qu’arbitraire et barbarie), grâce à l’introduction du droit de propriété, a été aussi un moteur pour l’action concrète (...)
Entre, d’une part, l’expropriation usurpatrice et l’expulsion des hommes, amplement pratiquées dans les régions de conquête et d’occupation, et, d’autre part, la récupération par la résistance ou la rébellion, que ce soit par la victoire révolutionnaire ou par la volonté de l’Etat et de la loi, voire, par le biais du marché et de l’accumulation de capital, dans un rapport de forces particulièrement favorable, la dynamique de la possession et de la dépossession a eu mille visages et mille itinéraires. (...)
l’objectif de cet ouvrage, issu d’une session double du congrès européen d’histoire rurale de Gérone, en Catalogne, a été de repérer d’une façon intégrale ces différents cas et expériences d’appropriation, de désappropriation et de réappropriation, qu’ils soient européens ou extra-européens, qu’ils soient plus ou moins ponctuels ou plus ou moins durables, entre le 16e siècle et le 21e siècle. (...)
L’ouvrage peut être divisé en trois parties, autour des trois questions centrales qui apparaissent toutes dans les textes retenus, à savoir : les formes de la dépossession, les enjeux de la résistance, et le rôle de l’État. (...)
