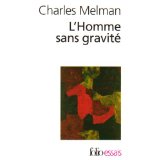
La machine mass médiatique est arrivée aujourd’hui à un point inédit de déphasage avec les citoyens. Imbriquée à ce qui est devenue la « machine politique », elle avale les scandales les uns après les autres, en les banalisant par son formatage implacable. La catastrophe nucléaire de Fukushima, les conflits d’intérêts derrière les scandales sanitaires, les affaires qui ébranlent le cœur même de notre République…rien ne semble arrêter la machine à dénis. Aujourd’hui, si le scandale Cahuzac et les révélations des « Offshore Leaks » ne font pas cran d’arrêt, les « nouveaux chiens de garde [1] » auront bel et bien réussi à verrouiller totalement la parole et le débat démocratiques.
La scène médiatique occupe l’espace central de la production du sens…
Dans toute société, il existe un espace tiers où se construit le sens collectif, et c’est sur lui que s’adosse le pouvoir politique pour se justifier. Au contraire du sens « absolu » d’une société soumise à la tyrannie, la production du sens démocratique doit s’adosser à un espace de débat pluraliste, où les citoyens savent qu’ils peuvent participer à sa définition. C’est à travers cet espace que se fait le « contrôle continu » du pouvoir pour que ce dernier ne dérive pas vers un pouvoir particulier. Aujourd’hui, la société française tient encore, dans son imaginaire politique, autour des valeurs de la République et de sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». « L’espace public » est censé être cet espace du débat démocratique, au cœur de la société. Mais que reste t-il aujourd’hui de cet espace ? Où le pouvoir politique va t-il aujourd’hui défendre sa légitimité ? A quel espace s’adosse t-il réellement ?
A n’en pas douter, c’est la « scène mass médiatique[2] » qui occupe cet espace, c’est à travers elle que le pouvoir politique (et économique) se donne à voir et se légitime. Elle s’est érigée comme l’intermédiaire de notre vie publique, en prétendant représenter la société – par les enquêtes d’opinions en particulier - et être la scène de confrontation démocratique où les « responsables » viennent s’adresser à la population. A travers elle, nous vivons par procuration, en tant que spectateurs, ce que nous devrions vivre en participant, au sein de vrais espaces de débat. Nous lui avons progressivement laissé le pouvoir suprême de parler à notre place. (...)
Sans plus aucun obstacle idéologique après le déclin du communisme, l’économie de marché a investi les médias et créé des monopoles inédits aux profits d’intérêts privés. Cette nouvelle scène mass médiatique, clinquante comme le marché publicitaire sur lequel elle s’adosse, a été un boulevard inespéré pour cette pensée consensuelle souhaitée jusqu’au plus haut niveau de l’Etat. « La politique est devenue une forme publicitaire » où la question de la parole n’est plus que celui de sa mise en scène, les années 80 marquant la « transition de la politique à la publicité, de l’Histoire à l’actualité, de la critique à l’expertise[6] ». Pour évacuer complètement le débat, il faut évacuer aussi les sujets[7], ce que la scène mass médiatique sait bien faire en dépersonnalisant les rapports (...)
les messages circulent sans être actualisés dans des relations sociales, à l’image de ce qui passe sur la scène marchande – grande inspiratrice de la scène médiatique - où les messages publicitaires anonymes s’adressent à la masse anonyme des consommateurs. (...)
Ces deux scènes dominantes du langage (la marchande et la mass médiatique), omniprésentes dans nos vies, nous ont peu à peu habitués à une communication qui évacue la réciprocité, une communication sans sujets, qui laisse croire que ce qui fait « vérité » ou « sens » peut se passer de notre participation. Jean-Pierre Lebrun voit apparaître là « un niveau supplémentaire de mainmise sur le sujet. On n’a plus recours aux méthodes traditionnelles, comme quand les totalitarismes utilisaient ouvertement et délibérément les techniques classiques de contrôle et de propagande pour avoir prise sur le sujet. Aujourd’hui, pour réaliser cette mainmise, on agirait en évidant le lieu même du sujet »[9]. Dans cette ère du renoncement à penser, quoi de plus logique que de désigner comme espace de production du sens commun cette scène qui verrouille le débat et renvoie les citoyens à leur impuissance ?
Nombre de nos gouvernants ont souscrit à ce langage, à l’esthétisation des relations qu’il impose, où c’est désormais l’image (sans faille) qui fait le message (...)
Au moment où la « langue de bois » n’a jamais autant occupé la scène, des psychanalystes soulignent l’urgence de revivifier la parole en nous la réappropriant, notamment via ces autres formes de langage (poétique, fictionnel, témoignages subjectifs…) qui parlent depuis notre intériorité, et qui ont été trop souvent relégués par le discours de « l’expert médiatique ». Le psychanalyste Roland Gori en appelle à notre capacité de créer et de nous raconter des histoires : « L’art de conter est en train de se perdre. Il est de plus en plus rare de rencontrer des gens qui sachent raconter une histoire. Et s’il advient qu’en société quelqu’un réclame une histoire, une gêne de plus en plus manifeste se fait sentir dans l’assistance. C’est comme si nous avions été privés d’une faculté qui nous semblait inaliénable, la plus assurée entre toutes : la faculté d’échanger des expériences (…). Une chose est sûre, si nous laissons sombrer l’art du récit et le goût de la parole, il n’y aura bientôt plus personne pour défendre la démocratie. Parce qu’il n’y aura plus de culture véritable où se fondent subliminalement le singulier et le collectif, le politique et la subjectivité »[10]. (...)
pour mieux comprendre le monde, nous n’avons pas besoin de plus d’informations, mais de plus d’espace d’échanges pour organiser le sens ensemble, ce qui implique de vrais espaces de débats démocratiques. Heureusement, des médias indépendants épris de démocratie – comme Médiapart, Indymédia, Là-bas si j’y suis, Politis…– promeuvent une approche participative de l’information qui redonne sa place au citoyen. (...)
Sans symbolique, nous n’avons plus de garde-fou contre la saisie directe des objets (les autres, les biens…), cibles de nos pulsions. Sans symbolique, construit par la culture, l’autre devient un objet dont je peux jouir sans avoir la moindre conscience que je l’utilise comme objet. Le symbolique, en faisant exister en nous la conscience du grand Autre (la figure universelle de l’autre), nous ouvre ainsi au respect. Toutes les cultures cultivent ce visage de l’altérité qui apprend le respect. C’est, par exemple, dans l’Evangile, le « dernier des derniers », l’absent à qui l’on pense quand on est réunis ; c’est, dans de nombreuses cultures, l’assiette de l’hospitalité à la table, devant la chaise vide de l’éventuel hôte de passage. A l’échelle d’une société, ce respect de l’altérité est cultivé par des grands principes incarnés dans des symboles communs, comme par exemple, l’égale dignité devant la loi incarnée par la République. Les scènes marchande et médiatique, en évacuant la pensée, érodent la construction du symbolique ; en banalisant une communication sans sujets et sans réciprocité, elles dissolvent à petit feu la conscience de l’Autre, dissolution favorisée par l’imaginaire marchand qui pousse à adhérer à ses pulsions de jouissance. Et sans cette conscience, la barbarie guette. (...)
Avec le « séisme Cahuzac », on commence à comprendre l’ampleur de la collusion des intérêts entre les « gens de pouvoir », qu’ils soient issus de la classe politique – de droite ou de gauche- du monde des mass médias, de la finance ou du show business ; on commence à comprendre à quel point les idées et les principes sont secondaires pour eux ; on commence à prendre conscience qu’ils ne sont pas dignes d’occuper la place du symbolique. (...)
Certaines voix font aujourd’hui irruption au cœur de la scène pour poser la question du sens, ouvrant des pistes pour construire de nouveaux imaginaires.
La re-symbolisation est en marche : les exemples de Pierre Rabhi et Edwy Plenel (...)
tous deux parlent de limites à fixer pour faire exister le respect : Pierre Rabhi nous rappelle que nous dépendons de la terre, ce grand Autre silencieux que nous sommes en train de détruire ; il parle de ce tiers, invoquant ce sens des limites que l’écologie politique nous apporte, résumé par la formule « Une croissance infinie dans un monde fini est une absurdité ». Edwy Plenel revivifie les principes républicains héritiers de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, qui nous relient à notre histoire, à l’éthique d’une presse démocratique, contre-pouvoir essentiel dans une République digne de ce nom. Mediapart, c’est aussi l’intégration, dans ce combat humaniste, des potentialités de la Toile, réalité devenue incontournable, et creuset incroyable d’ouvertures si on veille à sa structure participative. (...)
