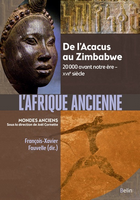
Les éditions Belin ont confié la direction de l’ouvrage sur l’Afrique à l’historien François-Xavier Fauvelle, au sein de leur collection « Mondes anciens ». Professeur au Collège de France, il revient ici sur les aspects majeurs de l’histoire de l’Afrique ancienne.
Nonfiction : Comment est né ce projet de l’écriture d’une histoire de l’Afrique ancienne et comment l’avez-vous mis en œuvre ?
François-Xavier Fauvelle : Ce livre est né d’une rencontre au festival du livre d’histoire de Blois en 2015. Judith Simony, éditrice d’histoire chez Belin, est venue me voir et m’a proposé d’écrire un livre pour cette maison d’édition. J’ai décliné, tout en faisant une contre-proposition, que j’avais en tête depuis longtemps et qui me paraissait correspondre au savoir-faire de Belin en matière de livres de référence destinés au public : une grande synthèse collective sur l’histoire de l’Afrique ancienne. Nous avons commencé à travailler, puis le projet a été accueilli par Joël Cornette dans la collection « Mondes anciens », où rien n’était prévu sur l’Afrique au départ. C’est ainsi que le projet a d’abord trouvé son berceau. Il a fallu ensuite le faire naître et prospérer, ce qui a consisté à concevoir une somme dont il n’existait pas vraiment d’équivalent sur le marché. Il a fallu élaborer le sommaire en fonction des spécialistes existants, parfois très peu nombreux dans certaines aires. Tous les contributeurs et contributrices se sont prêtés au défi d’écrire des chapitres qui soient des synthèses des connaissances les plus récentes, alors même que parfois de semblables synthèses n’étaient plus disponibles depuis longtemps et qu’elles exigeaient un effort de remobilisation de la documentation.
Un autre défi a été que l’état de la recherche n’est pas homogène, que les types de documents ne sont pas les mêmes dans les différentes régions d’Afrique. Mais nous avons fait de ce défi le fil rouge du livre. (...)
Vous privilégiez une histoire plurielle, notamment en parlant de « continents d’histoire », qu’entendez-vous par là ?
J’écris dans l’introduction que l’Afrique est un continent géographique mais plusieurs continents d’histoire. On ne peut en effet pas rapporter toute l’histoire du continent à une seule trajectoire, même à très grande échelle chronologique. En Afrique, sans doute pour les raisons qu’on vient d’aborder, les sociétés n’ont pas emprunté la voie qui passe d’une économie de chasseurs-cueilleurs, qu’en Europe on appelle Paléolithique, à une économie de production alimentaire, qu’on appelle Néolithique, puis aux âges des métaux, puis aux empires, etc. La production alimentaire prend en Afrique des formes multiples, qu’on ne peut pas rapporter à un Néolithique unique. En outre, des sociétés ont continué jusqu’à aujourd’hui à pratiquer la chasse, la collecte, la cueillette, la pêche. De même, beaucoup de sociétés africaines ont développé anciennement des techniques métallurgiques, mais elles ne sont pas du tout passées par les mêmes phases qu’en Eurasie. Tout cela trouble notre vision évolutionniste de l’histoire. Et trouble nos chronologies, notre vocabulaire, nos descriptions. (...)
Comment expliquez-vous ce nouvel intérêt pour l’histoire du continent africain ?
Il existe une curiosité, chez les lecteurs et les lectrices, pour l’histoire de l’Afrique, je dirais même un désir. Il s’exprime chez tous les lecteurs et lectrices, particulièrement chez celles et ceux qui se sentent frustrés d’avoir été privés de connaissances, ou qui savent que les savoirs en histoire africaine procèdent toujours « contre » quelque chose : contre l’ignorance, contre le déni d’histoire, contre la minimisation du traumatisme de la traite esclavagiste, contre les clichés qui « naturalisent » l’Afrique, etc. L’intérêt actuel du public pour l’histoire du continent se nourrit donc à la fois de la mise au jour d’un scandale et du plaisir de la découverte. C’est une bonne nouvelle pour l’histoire de l’Afrique. C’est aussi une bonne nouvelle pour notre société, qui commence à comprendre que la grande conversation sur notre passé, nos passés, nos origines, nos trajectoires collectives et individuelles, ne peut pas avoir lieu en l’absence de l’histoire des sociétés africaines.
