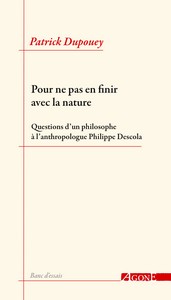
Patrick Dupouey, en lecteur informé de Philippe Descola et en admirateur de son œuvre savante, propose une critique de ses fondements philosophiques pour repenser ses implications politiques.
Peut-on renoncer à l’opposition nature/culture, comme y invite l’anthropologue Philippe Descola dans Par-delà nature et culture ?
La proposition centrale de cet ouvrage majeur est de s’affranchir de concepts et de distinctions pourtant consacrés par l’histoire de la philosophie. Dès sa première expérience de terrain, chez les Achuar d’Amazonie, Descola commence, écrit-il, à « comprendre que les notions de nature et de société n’ont aucun sens ». La nature serait, selon lui, une invention de la modernité européenne, qu’il date du XVIIe siècle, sur le terreau de la révolution scientifique galiléo-cartésienne. S’il faut se passer de son concept, c’est parce qu’il va de pair avec la séparation progressive des humains vis-à-vis des non-humains, installant les premiers dans une position de supériorité moralement inacceptable.
On sait le succès de ces thèses : pour des raisons politiquement consistantes (les préjugés attachés à l’idée de nature se traduisent en inégalités, discriminations, voire génocides), elles sont en passe d’acquérir le statut de pensée dominante. C’est pourquoi la déconstruction des fondements philosophiques de la pensée de Descola qu’entreprend Patrick Dupouey, nourrie d’une connaissance approfondie des travaux de l’anthropologue et d’une authentique admiration pour le savant, est précieuse.
Nature du naturalisme
Dans la mesure où Descola justifie politiquement ses thèses, Dupouey s’efforce de montrer que, même sur ce terrain-là, l’idée de nature et l’opposition nature/culture nous sont utiles : combattre les préjugés qui tiennent à la supposée naturalité de l’ordre social suppose d’exhiber leur origine culturelle. N’avons-nous pas le plus grand besoin de l’opposition nature/culture afin de contester l’existence d’obligations naturelles qui, par exemple, assigneraient les femmes à la procréation et aux soins à leur progéniture ?
Mais l’essentiel des critiques du philosophe à l’anthropologue se situe sur le terrain philosophique. Nous retiendrons, tout à fait subjectivement, quelques aspects de la démonstration de l’auteur. (...)
L’intérêt majeur de la démonstration de l’auteur est qu’elle permet de décrire l’unité de la conception philosophique de Descola. Aussi la confusion sur le naturalisme n’est-elle pas sans lien avec un fort ancrage relativiste.
Le sacrifice de l’universel
L’anthropologie, par la collecte des variations culturelles, est la discipline qui atteste de la contingence de formes culturelles au sein d’une humanité possédant, en tant qu’espèce, une incontestable unité biologique. Mais sa tâche ne se limite évidemment pas à l’inventaire de ces formes. Elle fait le pari qu’il existe des nécessités sous-jacentes intelligibles. Un relativisme culturel modéré, méthodologique en quelque sorte, est inséparable de la démarche anthropologique. Mais ce geste originel ne doit pas conduire à l’idée d’une totale discontinuité entre les cultures, d’une incommensurabilité entre elles, c’est-à-dire à un relativisme culturel radical auquel Descola donne le sentiment d’adhérer. (...)
L’appartenance de genre, la condition raciale, l’héritage social ne sauraient constituer les conditions contraignantes de l’exercice intellectuel. Descola s’oppose à l’affirmation réaliste d’un monde unique et vrai, d’un réel non seulement indépendant mais connaissable, au profit de celle, constructiviste (ou corrélationniste), d’un monde qui n’aurait de réalité que corrélative à l’identité et à la situation du sujet qui le perçoit.
On voit à quelles conséquences indésirables une telle position est exposée. La moindre n’est pas d’entretenir une forte méfiance à l’égard de la démarche scientifique. (...)
À l’évidence, les intentions généreuses que Descola met au principe de sa démarche sont desservies par la renonciation à rechercher, parce que nées en Occident, des catégories effectivement plus conformes à la texture et à la structure des choses, celles-là mêmes que la science moderne se propose de mettre au jour. Or, Descola, opposé à toute démarche métaphysique, est indifférent à l’étude de la structure fondamentale de la réalité. Il n’entre pas dans son projet de déterminer les propriétés des choses, de décrire l’ameublement ultime du monde, ces objectifs supposant de concevoir une nature indépendante de la connaissance que nous pouvons en avoir (...)
Descola, citant Whitehead, rappelle que les « bords de la nature sont toujours en lambeaux » : devrions-nous alors nous abstenir d’examiner la forme de ses contours ? La réponse de Patrick Dupouey, dans sa magistrale leçon, ne laisse pas de place au doute.
Pour ne pas en finir avec la nature. Questions d’un philosophe à l’anthropologue Philippe Descola- Patrick Dupouey - 2024 - Agone - 2024 pages
